 |
| @helloitsanha x eikimoze ⚡️ |
Wes, le Bernardaud du cinéma
Avec The Phoenician Scheme, Anderson délaisse les pensionnats huppés, les hôtels poussiéreux et les scouts suicidaires pour s’attaquer ou du moins effleurer du bout de son pinceau au film d’espionnage industriel postcolonial. Le pitch ? En 1950, Anatole « Zsa-Zsa » Korda, magnat du béton phénicien à mi-chemin entre Elon Musk et Hercule Poirot sous Tranxène, tente de transmettre son empire à sa fille devenue nonne, tout en menant un projet délirant de route commerciale méditerranéenne.
Sauf que dans ce joli château de sable aux allures de Monaco soviétique, rien ne tient en place : espions, diplomates véreux, émissaires du Vatican, et même un Dieu débonnaire joué par Bill Murray s’en mêlent. On croirait un Mission Impossible réécrit par Marguerite Duras et mis en scène dans un magasin Habitat.
La forme contre-attaque
Anderson n’a jamais été un scénariste de la trempe d’un Charlie Kaufman ou d’un Sorkin. Il compense depuis ses débuts par un style immédiatement reconnaissable et cette esthétique qui rappelle Truffaut sous Lexomil, Godard au musée de cire. Or, dans The Phoenician Scheme, l’histoire semble totalement phagocytée par son propre emballage. On croirait un épisode de C’est pas sorcier réalisé par Stanley Kubrick sous acide. Chaque personnage parle comme un télégramme.
Exemple : – « Tu trembles. » – « Ce n’est pas l’amour, c’est la guerre. » – « Alors aimons en silence. » Rideau. Plan fixe. Couleur pastèque. Musique baroque. Cadrage millimétré. Silence. Refonte du mythe d’Orphée à la sauce Pinterest.
Un syndrome d’Anderson ?
La vraie question n’est plus de savoir si Wes Anderson est un bon réalisateur (la réponse est oui), mais s’il est encore un cinéaste vivant. Car The Phoenician Scheme, malgré ses jolis atours, transpire la paresse. Pas celle d’un artisan fatigué. Celle d’un artiste qui s’autocite avec la frénésie d’un plagiaire officiel. On repère les motifs comme dans un bingo :
📷 Jeune garçon mélancolique avec un appareil photo ? Check.
🍶 Adultes émotivement inaccessibles ? Check.
🌍 Monde clos et désuet ? Check.
😄 Récit fragmenté en chapitres avec voix-off monocorde ? Évidemment.
🌬️ Bill Murray déguisé en consul phénicien ? Jackpot.
L’amour selon Wes : même chagrin, nouveau vase
Dans The Phoenician Scheme, l’amour est encore une fois affaire de regards fuyants, de lettres non envoyées, et de rendez-vous manqués dans des halls vides. C’est beau, oui, mais c’est surtout toujours la même chose.
Depuis Moonrise Kingdom, Anderson décline la même idylle contrariée : deux êtres en décalage, réunis par le sort, séparés par une tragédie vintage, réconciliés dans un dernier plan sur fond d’orage stylisé. Mais à force d’aseptiser les émotions sous une couche de vernis sépia, on finit par ne plus rien ressentir du tout. L’amour chez Anderson, c’est un acte purement mental, désincarné, plus proche de l’exercice de style que du coup de foudre. On sort de la salle avec le cœur intact, le cerveau intrigué, et l’âme... vaguement polie.
The Phoenician Scheme ou le syndrome du Louvre
Ce film ressemble à une salle du Louvre rénovée : tout y est superbe, bien éclairé, encadré, documenté... mais impossible de s’y attacher vraiment. On admire, on soupire, on photographie, on oublie. Le cinéma de Wes Anderson est devenu un musée ambulant. Et dans ce musée, l’amour n’est qu’un artefact. Et pourtant, certains crient encore au génie.
Il faut dire que critiquer Wes Anderson, aujourd’hui, c’est un peu comme insulter la vaisselle de Mamie : c’est fragile, c’est précieux, et ça ne se fait pas. Mais il faut bien l’admettre : The Phoenician Scheme est peut-être le plus beau film ennuyeux de l’année.
Postface : Wes Anderson, ce prestidigitateur de l’ennui luxueux
Alors, Wes Anderson nous lasse-t-il ? Oui, un peu. Beaucoup, parfois. Passionnément, chez les plus lucides. À force de tourner en rond dans ses univers feutrés, il finit par devenir son propre musée Grévin. Certes, il reste un créateur inégalé de formes.
Mais à quoi bon bâtir des cathédrales si c’est pour y prier les mêmes refrains depuis vingt ans ? The Phoenician Scheme, c’est du cinéma pour Instagram : parfait dans le cadre, absent dans le fond. Et l’amour, dans tout ça ? Toujours là, mais prisonnier de sa propre mise en scène. Comme si, chez Wes, le seul véritable amour était celui qu’il voue à son miroir.
N’étant pas fan de Wes Anderson j’attendais pas mal #thewonderfulstoryofhenrysugar est malheureusement je n’aime toujours pas le style Wes Anderson, le moyen métrage ne fait que 39 minutes et je m’ennuie terriblement le film et beau et impressionnant esthétiquement malgré ça. pic.twitter.com/5ux6DbSpve
— Dylan Paraire (@Dylanparaire) September 27, 2023
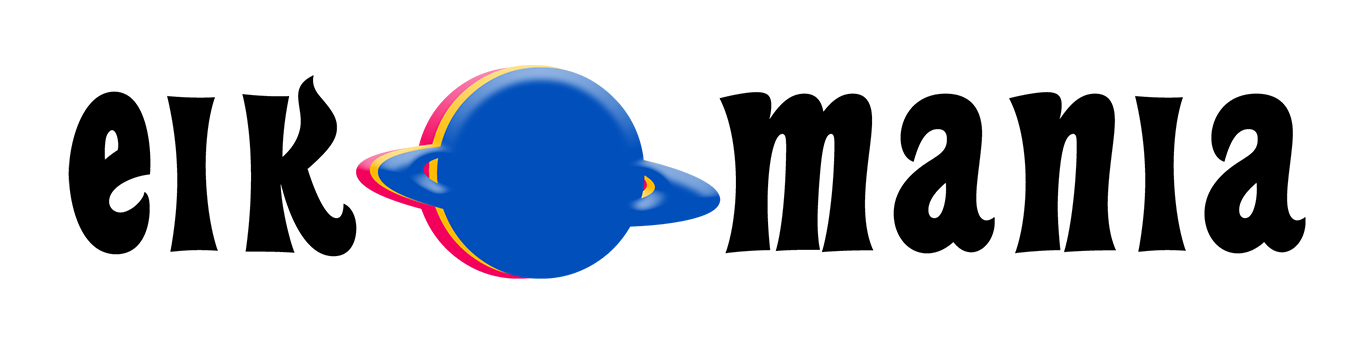


Commentaires
Enregistrer un commentaire